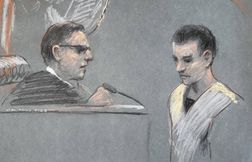Face à la profusion d’images en ligne, à quoi servent encore les photoreporters de guerre ? Ils nous répondent
Dans l’Œil de•Avec les réseaux sociaux, les guerres en Ukraine comme dans la bande de Gaza, se déroulent presque en direct. Les images sont diffusées très rapidement. Devant cette abondance, des photojournalistes de guerre défendent l’importance de leur travail
Emilie Jehanno
L'essentiel
- Sur les réseaux sociaux, la guerre Hamas-Israël se déroule presque en direct et les images ou vidéos (vraies ou fausses) ont inondé les plateformes depuis le 7 octobre.
- Comment raconter et montrer l’horreur de la guerre ? Faut-il être présent sur les réseaux sociaux ? Des photojournalistes de guerre, rencontrés au festival des correspondants de guerre à Bayeux, nous racontent les défis de cette profession face à la profusion d’images ou de vidéos en ligne.
«Nos vies ici sont un film que vous regardez et vous pouvez changer de chaîne quand vous voulez. » Ces mots amers sont ceux de Motaz Azaiza, un des rares photojournalistes palestiniens qui documente la guerre depuis la bande de Gaza, et poste sur ses comptes Instagram, Facebook ou YouTube. Sur les réseaux sociaux, la guerre Hamas-Israël se déroule presque en direct et les images ou vidéos (vraies ou fausses) ont inondé les plateformes depuis le 7 octobre.
Dans cette guerre, les journalistes et photoreporters internationaux ne peuvent se rendre sur place pour travailler : Israël en interdit l’accès pour des raisons sécuritaires, sauf pour des reportages embarqués avec l’armée israélienne. Reporters sans frontières a dénoncé le fait que Tel-Aviv « étouffait progressivement l’information dans la bande de Gaza », en tuant ou blessant des journalistes, détruisant des rédactions, coupant Internet. Trente-six reporters ont été tués sur ce petit territoire depuis l’attaque terroriste du Hamas sur Israël, le 7 octobre. L’association exige la protection de ceux qui restent, comme l’a aussi demandé Motaz Azaiza pour lui-même sur Instagram.
Ceux qui restent rappellent l’importance d’informer. Dans un témoignage publié dans The Economist le 27 octobre, le photojournaliste Ali Jadallah, qui a perdu 4 proches dans un bombardement, raconte comment il travaille avec six autres collègues pour couvrir la guerre. Ils sortent le matin pour photographier les bombardements de la nuit. « C’est dangereux dehors, donc, je leur donne 7 minutes pour prendre des photos et revenir à l’hôpital », où ils ont trouvé refuge dans le nord de la bande de Gaza. « Le plus important maintenant, c’est de rendre compte de ce qui se passe, raconte-t-il. Mon équipe et moi-même ne mangeons pas vraiment et ne dormons pas plus de quelques heures par nuit. »
« Les réseaux sociaux sont saturés de millions d’images »
Comment raconter et montrer l’horreur de la guerre ? Faut-il être présent sur les réseaux sociaux ? Le photojournaliste indépendant, Siegfried Modola, qui a remporté le prix Nikon en octobre dans la catégorie photo au festival des correspondants de guerre de Bayeux, essaie de rester aussi éloigné que possible des plateformes.
« Mon travail consiste à sensibiliser les gens en tant que photojournaliste, explique-t-il à 20 Minutes, alors qu’il était en Afghanistan fin octobre. Et les réseaux sociaux sont saturés de millions d’images qui peuvent parfois avoir un impact, mais souvent elles embrouillent la situation parce qu’elles brouillent la vérité. » Facebook, Instagram, X ou TikTok répondent très vite à la demande d’information, mais ces plateformes déstabilisent aussi le modèle économique des photoreporters, car « il y a moins de financement pour les photoreportages en free-lance, et les médias en général », regrette-t-il.
La recherche de crédibilité
Le photojournaliste italo-britannique estime cependant qu’elles jouent un rôle important quand les journalistes ne sont pas sur le terrain, mais ces vidéos ou images doivent être remises dans leur contexte. « Nous ressentons immédiatement quelque chose quand nous regardons une image sur les réseaux sociaux. Et je crois que c’est là le danger, analyse celui qui a couvert des conflits en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Sud. Nous devons vérifier si ce que nous voyons est vrai, si cela vient de l’endroit où la légende le dit. Car nous avons vu à maintes reprises que la propagande est utilisée de cette façon par des États et différents acteurs. »
Cette recherche de vérité et de crédibilité, c’est aussi un des fondamentaux du photojournalisme pour Enric Marti, commissaire de l’expo « Ukraine : Lignes de fronts » à Bayeux. Le photoreporter espagnol, qui a traité la guerre en Bosnie-Herzégovine, puis au Moyen-Orient pour Associated Press, rappelle que « tout le monde peut se dire photographe aujourd’hui, car tout le monde peut prendre une photo avec son téléphone ». « Le rôle d’un photojournaliste, c’est d’apporter de la crédibilité, souligne-t-il auprès de 20 Minutes. Nous avons besoin d’avoir des professionnels qui couvrent et documentent ce qu’il se passe d’une façon précise. Et c’est très difficile. »
Un chemin difficile en Ukraine
L’apprentissage de ce chemin professionnel a été compris durement par Vlada et Konstantyn Liberov, un couple de photographes ukrainiens qui prenait des photos de mariage avant la guerre en Ukraine. L’invasion russe en février 2022 a tout changé pour eux : leur métier, leur vision de la photo, leur rapport à l’information. A Boutcha, ville où des civils ont été massacrés, ils ont voulu prendre en photos les vivants pour donner espoir, après la libération de cette ville en avril 2022. Une volonté qui s’est retournée contre eux, car la propagande russe a utilisé leurs images pour affirmer qu’il n’y avait pas eu de massacre, ont-ils raconté à 20 Minutes lors du festival des correspondants de guerre à Bayeux.
« Nous avons compris alors que nos photos n’ont pas pour but de donner de l’espoir ou de soutenir les gens, affirme Vlada Liberov, mais qu’elles doivent montrer la vérité. Et si nous savons que ce que nous montrons est complètement vrai, alors nous sommes protégés de ceux qui utilisent nos photos d’une autre manière. » Cette quête de véracité, ils l’ont encré jusque dans leur peau, en se tatouant le mot vérité en ukrainien sur leur poignet.
« Il faut être capable de parler aux gens »
Faire en sorte qu’une photo, parmi des millions, ait un impact demande de savoir construire un récit, d’avoir un contexte. « C’est à ce moment-là que l’on a besoin de notre profession, défend Siegfried Modola. Dans ce domaine, il faut des années de photographie pour devenir un bon photojournaliste. Il faut être capable de parler aux gens, de se mettre en situation, de faire des recherches, de connaître l’histoire sur laquelle vous travaillez. » Il y voit une grande différence avec les réseaux sociaux, dans lesquels circulent beaucoup d’images et d’opinions, « mais rien n’est rassemblé de manière concise qui puisse avoir un sens et une narration, un début et une fin », plaide-t-il.
Depuis le coup d’État en 2021 au Myanmar, il couvre le conflit peu médiatisé dans ce pays d’Asie du Sud-Est, où il s’est rendu trois fois. Lauréate du prix Nikon, sa photo de soldats de la rébellion Karenni se réfugiant dans un fossé alors qu’un obus de mortier explose à proximité a été prise le 16 avril 2023, dans l’est du pays. Elle frappe par son regard. « Cette image fonctionne, car on voit la peur dans les yeux de ce très jeune homme, la fumée qui se dégage de la chute du mortier, mais on comprend aussi ce à quoi ces jeunes gens de la rébellion sont confrontés chaque jour », souligne-t-il.
Comment photographier la violence d’une guerre
Le photoreporter de guerre documente, donne un contexte, construit un récit, mais, jusqu’où aller dans l’illustration de la violence ? Y a-t-il une limite ? « Aujourd’hui, on est anesthésié par les images de violence », estime Lorenzo Meloni. Le photoreporter italien a travaillé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pendant dix ans, notamment sur la chute de Kadhafi en Libye et de l’Etat islamique en Syrie et en Irak.
Il nous raconte son rapport à la violence. « Quand je suis sur le terrain, je ne fais pas de censure, je n’ai pas de filtre, je prends en photo tout ce que je peux, retrace-t-il. S’il y a des cadavres, des moments violents, je ne m’arrête pas. je suis dans un moment où je n’ai pas le temps de réfléchir, c’est assez instinctif. » Ce temps de réflexion, il le prend ensuite au moment de l’editing, quand il sélectionne ses photos, voit celles qui ne sont pas nécessaires et réfléchit sur ce qu’il veut montrer.
La limite pour lui, c’est de ne pas inspirer du dégoût ou de la répulsion. « Je veux qu’on entre en connexion avec la violence et qu’on regarde l’image, qu’on s’arrête pour se poser des questions, pour comprendre et voir », explique-t-il, indiquant utiliser une certaine esthétique et prendre de la distance avec le sujet photographié. « J’essaie toujours de faire un pas arrière, qu’il y ait un contexte, poursuit-il. Je ne travaille pas sur une seule image. » Pour les photoreporters interrogés, leur message se situe à l’opposé d’une exaltation de cette violence, « la seule vérité, c’est que la guerre, il ne faut pas la faire », conclut Lorenzo Meloni.
À lire aussi
Sujets liés